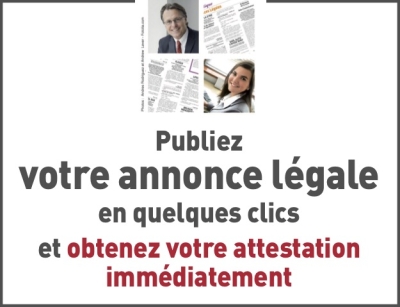Stockage de l’eau
Un protocole pour créer des retenues à usages agricoles
Un protocole sur la création de retenues d’eau à usage agricole a été signé dans la Loire en 2017. Visant à sécuriser l’agriculture ligérienne tout en respectant les règles environnementales, il précise les principes et les méthodes encadrant le suivi d’un projet.

La gestion de l’eau représente un enjeu fort pour l’agriculture du département de la Loire depuis de nombreuses années. L’autonomie fourragère des élevages et l’abreuvement des animaux sont notamment concernés, tout comme les activités de maraîchage. Le stockage dans des retenues constitue l’une des solutions pour remédier à la pénurie d’eau, dans un département qui dispose de peu de ressources en surface.
Un protocole sur la création de retenues d’eau à usage agricole est en vigueur dans la Loire depuis mars 2017. Etabli en déclinaison du protocole régional adopté en juillet 2012, il vise à inscrire la création de nouvelles retenues de stockage d’eau à usage agricole ou la modification de retenues existantes dans une logique de développement durable. Il définit les conditions dans lesquelles peuvent être conduits les projets et propose des éléments de méthode pour faciliter la définition et la conception des ouvrages selon les règles en vigueur.
Ce protocole concerne l’ensemble des retenues à usage agricole, c’est-à-dire « toutes les installations et ouvrages permettant de stocker de l’eau, quel que soit leur mode d’alimentation (cours d’eau, nappe, ruissellement, résurgence) ». Les projets doivent s’inscrire dans le territoire, répondre à un besoin avéré des exploitations et des filières agricoles, privilégier les retenues collectives plutôt qu’individuelles, être compatibles avec les dispositions des Sdage (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et du Sage (Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) Loire en Rhône-Alpes, avoir un fonctionnement adapté au cycle de l’eau et participer autant que possible à la sécurisation de la défense contre les incendies. Les signataires du protocole (lire par ailleurs) estiment que « la réussite des projets est conditionnée par une concertation et une prise de connaissance de l’ensemble des acteurs du territoire concernés le plus en amont possible ».
Chacun son rôle
Le protocole fixe les implications de chacun des acteurs. La Chambre d’agriculture assure le rôle de « porte d’entrée » lors de la phase initiale exploratoire du demandeur. « Elle apporte ses conseils pour la définition des besoins en eau, l’analyse territoriale et la prise en compte des ouvrages existants », mais aussi pour « l’approche économique du projet, la réalisation des études techniques nécessaires au dimensionnement des retenues et à l’évaluation des besoins ».
Les services de l’Etat ont pour mission de réaliser une analyse des solutions identifiées. Celles-ci doivent concilier les enjeux agricoles et environnementaux tout en étant compatibles avec la réglementation. De son côté, le Département, en plus des aides financières (études et travaux), apporte ses connaissances des milieux, du patrimoine naturel, des zones humides, des retenues existantes et de la défense des incendies.
Etapes d’un projet
Plus concrètement, dès l’émergence d’un projet de création de retenue d’eau à usage agricole, le demandeur doit suivre des étapes bien définies. A commencer par en faire part à la Chambre d’agriculture. Celle-ci accompagne l’agriculteur dans la définition technico-économique du projet. Au préalable, une réflexion sur sa pertinence aura dû être conduite, en suivant un schéma qu’elle propose avec plusieurs situations de départ : manque de fourrages chronique ; conversion de l’exploitation à l’agriculture biologique ; recours au réseau d’eau potable pour abreuver le troupeau ; disponibilités financières pour sécuriser le fonctionnement et offrir des opportunités (nouvelles productions, transmission) ; installation en maraîchage, petits fruits, fruits... ; diversification des productions et développement d’une production végétale.
Selon les réponses apportées pour remédier à ces situations, le porteur de projet est invité par la Chambre d’agriculture à évaluer ses besoins et les ressources en eau. Si l’écart entre les deux est déficitaire, une étude de faisabilité d’une retenue collinaire peut être lancée.
Une fois la fiche « projet de création de retenue d’eau » élaborée, elle est adressée à la DDT (Direction départementale des territoires). Sous deux mois, une visite sur site est organisée avec les acteurs pour partager les objectifs du projet et identifier les études préalables. Sous un mois, le service Police de l’eau précise les exigences réglementaires. Après l’achèvement des études, le dossier finalisé est déposé à la DDT. La durée d’instruction peut varier selon que le projet est soumis à déclaration ou à autorisation. La procédure d’autorisation est plus longue car elle nécessité la réalisation d’une enquête publique.
Lucie Grolleau-Frécon
Les signataires du protocole
Les signataires du protocole concernant la création de retenues d’eau à usage agricole sont : le préfet de la Loire de l’époque, Evance Richard ; le président du Conseil départemental, représenté par Chantal Brosse, vice-présidente en charge de l’agriculture ; le président de la Chambre d’agriculture, Raymond Vial, le président de la CLE (Commission locale de l'eau) du Sage Loire en Rhône-Alpes ; le directeur général de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ; le directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée ; le directeur régional de l’Agence française pour la biodiversité (ayant depuis intégré l’OFB, Office français de la biodiversité) ; le président de la Fédération départementale de la pêche de la Loire ; le président du Conseil régional et le président du Syndicat mixte d’irrigation du Forez (Smif).